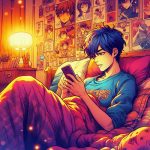Entre injonction à la déconnexion et dépendance numérique, les parents naviguent à vue. Dans l’article que nous vous présentons aujourd’hui, la sociologue Claire Balleys (Université de Genève) révèle que la gestion des écrans à la maison n’est pas seulement une question de volonté. Elle dépend étroitement du milieu social, des habitudes familiales et des contradictions d’une société connectée jusque dans ses moindres recoins.
On vous explique.
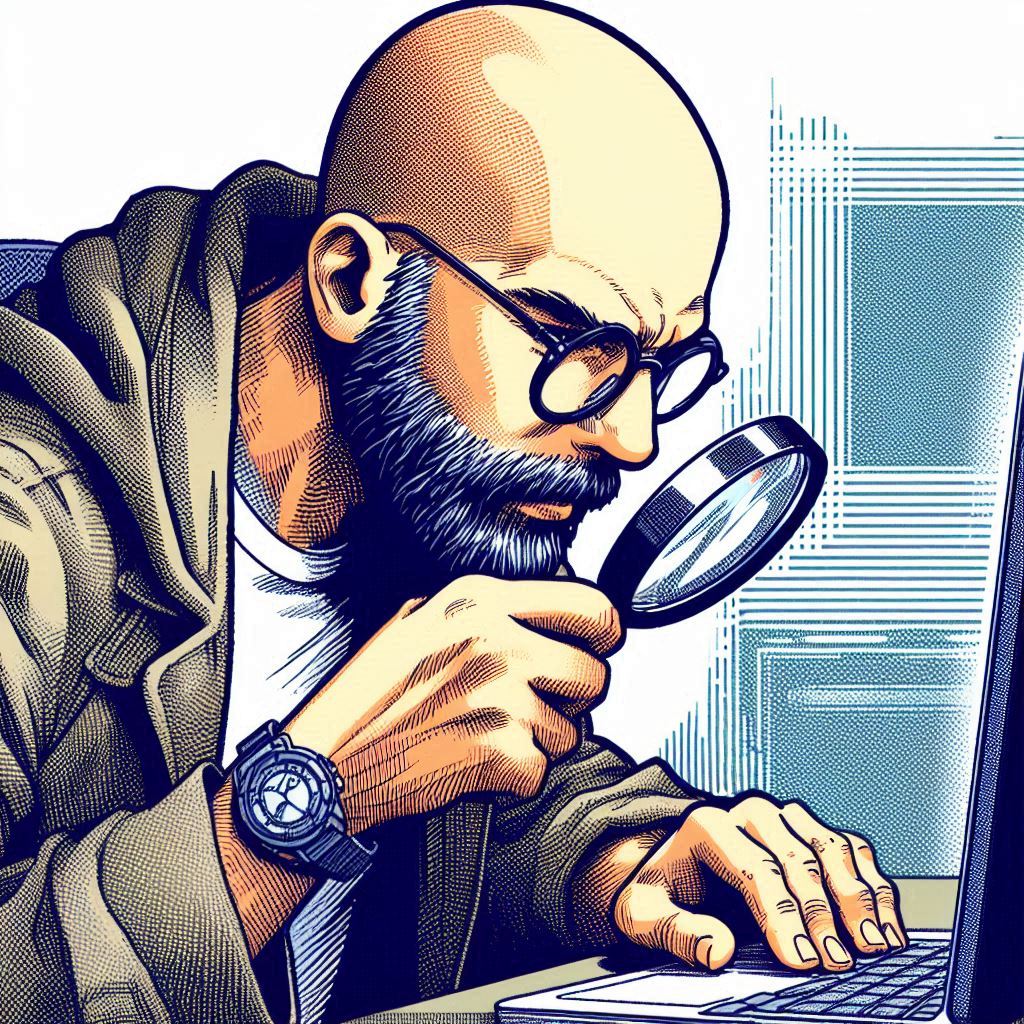
Une société connectée, des parents déboussolés
Le « temps d’écran » des jeunes est devenu un sujet de préoccupation central dans nos sociétés occidentales. Politiques, médias, experts : tout le monde y va de sa recommandation, plus ou moins éclairée. Pourtant, le paradoxe est flagrant. Dans une société où presque chaque activité passe par un smartphone – organiser un rendez-vous, s’informer, écouter de la musique, même s’orienter dans la rue –, comment demander aux adolescents de s’en détacher ?
Les parents, souvent inquiets, se retrouvent dans une position intenable. Ils doivent fixer des règles autour d’un objet qu’ils utilisent eux-mêmes en permanence. Le numérique s’est imposé dans toutes les sphères du quotidien, et la « bonne parentalité » se mesure désormais aussi à la capacité à réguler les écrans. Mais entre culpabilité et impuissance, nombreux sont ceux qui se sentent dépassés.
Quand les parents montrent l’exemple… à l’envers
Les enquêtes menées par Claire Balleys en Suisse romande, auprès de 15 familles et de 21 adolescents, montrent que la régulation parentale se heurte à un obstacle majeur : les usages des adultes eux-mêmes. Les adolescents observent, comparent et jugent. Ils constatent souvent que leurs parents sont « tout le temps sur leur téléphone », parfois même plus qu’eux. Difficile alors de faire passer un message crédible [1].
Certains pères gardent leur téléphone à table pour « un mail urgent », d’autres pour « changer la musique ». Les adolescents, eux, voient surtout une contradiction : « Faites ce que je dis, pas ce que je fais. » La règle du « pas de smartphone à table » est bien connue, mais rarement appliquée à la lettre.
Les jeunes dénoncent aussi le mépris implicite des parents pour leurs contenus en ligne. YouTube, TikTok ou les jeux vidéo sont jugés « idiots » ou « inutiles », souvent sans que les adultes ne s’y soient vraiment intéressés. En retour, les adolescents se sentent incompris et défendent leurs pratiques comme des espaces de sociabilité ou de détente. Ce décalage alimente les tensions et fragilise le dialogue. Le conflit autour des écrans devient un révélateur des rapports d’autorité au sein des familles.
Le repas familial, un miroir du lien social
Le moment du repas, autrefois sacré, est devenu un terrain d’observation privilégié. Pour certains, il reste un rituel de déconnexion : on pose les téléphones pour se parler. Mais pour d’autres, c’est justement l’absence de parole qui pousse à sortir les écrans.
Une adolescente interrogée, Inès, explique que chez elle, chacun mange devant son écran : « On n’a rien à se dire, autant être sur nos tél. » Ses camarades, issues de familles plus cadrées, s’en offusquent : « Chez nous, c’est le moment en famille ! ». Ce contraste montre combien la présence ou non des écrans à table dépend du climat relationnel. Là où la conversation est fluide, la déconnexion semble naturelle. Là où elle est absente, l’écran devient un refuge contre le silence.
Les campagnes de prévention qui prônent le « zéro écran à table » apparaissent alors déconnectées des réalités sociales. Dans certaines familles, les écrans ne détruisent pas le lien : ils permettent simplement que le repas ait lieu dans un climat supportable.

Temps d’écran : un révélateur des inégalités sociales
Si le débat public parle souvent de « trop d’écran », il ignore souvent une dimension essentielle : le contexte social. Les recherches de Balleys montrent que les jeunes des milieux modestes passent plus de temps connectés non par désintérêt pour le monde réel, mais faute d’alternatives. Les loisirs, les activités sportives ou culturelles coûtent cher ou demandent une logistique que toutes les familles ne peuvent assumer.
« S’il y a ennui à la base, ce n’est pas une perte de temps », résume Naomi, 17 ans. Les réseaux sociaux comblent le vide, distraient, font rire, apaisent l’ennui. L’écran devient une fenêtre sur l’extérieur dans un quotidien parfois restreint.
À l’inverse, les jeunes issus des milieux favorisés n’ont pas besoin de limiter activement leur temps d’écran : leurs journées sont déjà saturées. Devoirs, sport, musique, ski, activités culturelles… Leur agenda, rempli d’activités valorisées, réduit mécaniquement le temps passé devant les écrans.
L’ennui, ici, n’existe pas. Mais cette absence de vide est un privilège. Le contraste est frappant : pour les uns, les écrans remplissent un trop-plein de temps libre ; pour les autres, ils s’insèrent dans des emplois du temps structurés où chaque minute est comptée. Le temps d’écran devient ainsi un marqueur des inégalités sociales, tout autant qu’un sujet de santé publique.
Une lutte des classes 2.0.
L’écran, refuge et frontière
Au-delà de l’ennui, les écrans remplissent une autre fonction : celle de barrière protectrice. Certaines familles aisées préfèrent savoir leurs enfants à la maison, devant une console ou un téléphone, plutôt qu’à « traîner » dehors. Une mère raconte qu’elle interdit à son fils d’aller jouer au foot dans le quartier, jugé fréquenté par de la « faune » : un mot qui traduit bien la peur de la mixité sociale.
Dans ce contexte, l’écran devient paradoxalement un instrument de sécurité. Il enferme les adolescents dans un espace familier, loin des dangers perçus de la rue. Mais cette stratégie, en cherchant à éviter les risques extérieurs, favorise le repli et l’isolement numérique.
Certains parents vont plus loin en utilisant la géolocalisation pour suivre leurs enfants en temps réel. Ces pratiques de surveillance, censées protéger, empêchent toute réelle autonomie. Elles traduisent une contradiction propre à la parentalité contemporaine : vouloir que les enfants se déconnectent tout en les maintenant sous contrôle constant grâce à la technologie.

Déconnecter… mais à quel prix ?
En plaçant la question des écrans au cœur du débat sur l’éducation, notre société projette sur les familles un idéal difficilement atteignable. Les messages de prévention, comme ceux de la CAF invitant à « sortir, courir, danser, faire des claquettes », traduisent une vision élitiste du loisir. Car encore faut-il avoir les moyens, le temps, l’espace ou même l’envie de « danser » après une journée de travail éreintante.
Pour Balleys, il est essentiel de replacer ces injonctions dans leur contexte. Réguler les écrans ne se résume pas à fixer des horaires ou à installer des applications de contrôle parental. Cela implique de comprendre les conditions matérielles, sociales et émotionnelles dans lesquelles les familles évoluent.
Certaines utilisent les écrans pour survivre à la fatigue, à l’isolement ou à la précarité. D’autres y voient une menace pour la réussite scolaire ou le lien familial. Les usages, loin d’être uniformes, reflètent la diversité des modes de vie.
La double injonction impossible
« Ne traîne pas sur ton téléphone »… mais « ne traîne pas dans la rue » non plus. Entre ces deux injonctions contradictoires, les adolescents évoluent dans un espace de liberté de plus en plus réduit. Les familles modestes, craignant le danger des espaces publics, se replient sur le numérique. Les classes moyennes supérieures, quant à elles, survalorisent la maîtrise de soi et la déconnexion comme marqueur moral et culturel.
Au fond, souligne Balleys, seules certaines familles – celles qui disposent d’espace, de ressources et de capital culturel – peuvent réellement appliquer les règles idéales de déconnexion. Les autres font avec les moyens du bord, et les écrans deviennent un outil d’adaptation à leur réalité sociale.
Comprendre avant de juger
En conclusion, Claire Balleys invite à changer de regard sur les écrans. Plutôt que de diaboliser les pratiques adolescentes ou de culpabiliser les parents, il s’agit de comprendre comment les usages numériques s’inscrivent dans des trajectoires sociales, des dynamiques familiales et des ressources inégales.
Les écrans ne sont pas les ennemis de la jeunesse. Ils sont le miroir d’une société saturée de contradictions : connectée mais inquiète, protectrice mais méfiante, exigeante mais inégalitaire.
Réguler les écrans, c’est moins apprendre à éteindre un téléphone qu’à éclairer les conditions dans lesquelles on l’utilise. Car derrière chaque écran, il y a surtout une famille, une histoire, et un contexte à comprendre.