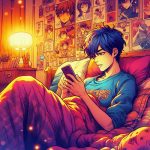En vingt ans, les réseaux sociaux ont envahi nos vies — et surtout celles des adolescents. Aujourd’hui en France, plus de 90 % des jeunes de 13 à 17 ans utilisent chaque jour au moins une plateforme comme TikTok, Snapchat, Instagram ou WhatsApp. Si ces outils favorisent les échanges et la créativité, de plus en plus de voix s’inquiètent de leurs effets sur la santé mentale. En effet, durant cette même période, la dépression des adolescent·es a fortement augmenté en France comme dans d’autres pays développés. Cette corrélation d’événements nous pousse à nous poser une question : les réseaux sociaux sont-ils responsables de cette hausse de la dépression ?
Une étude récente, publiée en octobre 2025 dans la revue PLOS Medicine par une équipe franco-américaine dirigée par le psychiatre Nicolas Hoertel (AP-HP, Université Paris Cité), apporte des éléments chiffrés à ce débat. La littérature scientifique avait jusque-là produit des résultats contradictoires : certaines études montraient un lien entre temps passé sur les RS et symptômes dépressifs, mais la causalité est difficile à démontrer, notamment à cause de la multiplicité des facteurs en jeu (stress, harcèlement, sédentarité, événements familiaux…).
À l’aide d’un modèle informatique inédit (la microsimulation), les chercheurs ont évalué l’impact de l’usage excessif des réseaux sociaux sur la dépression chez les adolescents français. Leurs résultats semblent clairs : l’usage intensif des réseaux sociaux pourrait expliquer une part importante de la hausse de la dépression adolescente observée depuis 2010.
On vous explique…
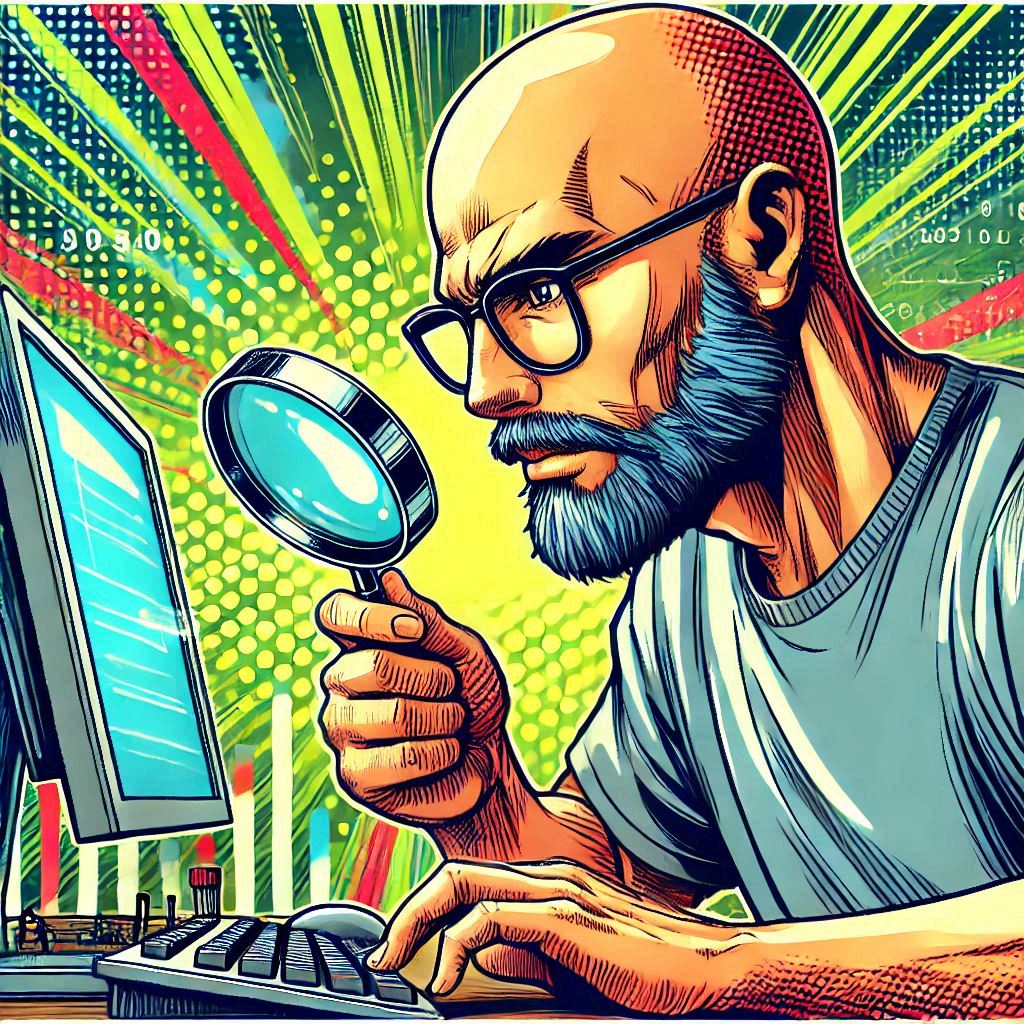
Un modèle pour simuler 18 millions de vies
Pour explorer cette question, les auteurs ont construit un modèle de microsimulation — une approche issue de l’épidémiologie numérique. Contrairement aux statistiques classiques, ce type de modèle simule le parcours de millions d’individus virtuels, chacun avec ses propres caractéristiques (sexe, âge, niveau d’activité physique, antécédents familiaux, etc.).
Leur modèle reproduit le destin de 18,6 millions d’adolescents français nés entre 1990 et 2012, et suit leur évolution de 2000 à 2022.
L’étude repose donc sur une méthode innovante appelée « microsimulation individuelle ». Cet outil modélise l’évolution de la santé mentale d’une population entière d’adolescent·es, tout en prenant en compte la complexité des facteurs de risque, l’exposition aux réseaux sociaux et l’effet possible de différentes mesures de prévention.
Principe général de la microsimulation
La microsimulation individuelle simule « virtuellement » la trajectoire de vie de millions d’individus, ici 18,6 millions d’adolescent·es français·es nés entre 1990 et 2012. Chaque individu virtuel est modélisé spécifiquement et caractérisée par de multiples paramètres (sexe, âge, antécédents familiaux, exposition aux violences, niveau d’activité physique, état de santé, addictions, etc.), nourris par des données françaises réelles et fiables (INSEE, Santé Publique France, OFDT, études épidémiologiques). En tout, 95 paramètres ont été intégrés.
C’est en quelques sortes une étude longitudinale virtuelle rétrospective.
Modélisation de l’exposition aux réseaux sociaux
Le modèle intègre l’arrivée progressive et l’adoption par tranche d’âge de chaque plateforme sociale (Facebook, Instagram, TikTok…), reproduit à partir de statistiques historiques (Médiamétrie) : taux de pénétration, plages d’exposition quotidienne, effet du lancement d’une nouvelle plateforme. L’exposition individuelle est calculée à partir d’une probabilité d’utilisation, d’une durée quotidienne (modélisée statistiquement selon les observations françaises) et du cumul de l’exposition dans le temps.
Modélisation du risque dépressif
Le risque de symptômes dépressifs à chaque âge est calculé en combinant :
- Les facteurs sociodémographiques (sexe, âge, année de naissance)
- Les antécédents familiaux de troubles psychiques
- Les adversités subies dans l’enfance (maltraitance, harcèlement)
- L’activité physique et la sédentarité
- Le surpoids/l’obésité
- Les addictions (tabac, alcool, cannabis)
- L’existence de maladies chroniques
- L’effet spécifique du confinement et de la fermeture des écoles pendant la pandémie de COVID-19.
Le modèle attribue à chaque facteur un poids (odds ratio issu de la littérature scientifique), puis calcule de façon probabiliste la survenue ou non de symptômes dépressifs année après année pour chaque individu virtuel.

Validation, calibration et analyses de sensibilité
Pour garantir la robustesse de la modélisation, le modèle a été calibré :
- Sur les données françaises observées de prévalence de la dépression chez les jeunes (enquêtes EHIS, EpiCov, PHQ-9)
- Sur l’évolution réelle du temps passé sur les réseaux sociaux (statistiques Médiamétrie)
- Puis validé sur les données américaines (en prédisant la prévalence de la dépression chez les ado·lescents américains sur 10 ans).
Des analyses de sensibilité ont été menées pour tester la robustesse des résultats par rapport aux variations des paramètres-clés (durée d’exposition, co-utilisation de plateformes, pondération des facteurs).
Interventions et comparaisons de scénarios
La force du modèle réside dans sa capacité à simuler divers scénarios de politique publique : suppression totale des réseaux sociaux, limitation à une heure par jour, remplacement partiel par de l’activité physique, ou ciblage des jeunes à haut risque. Chacun de ces scénarios est comparé à la situation actuelle, permettant d’estimer l’impact sur :
- Le nombre cumulé de cas de dépression
- Les pertes d’années de vie ajustées sur la santé
- Le nombre de décès par suicide associés
- Les coûts médicaux et productifs pour la société.
Les chercheurs ont ensuite comparé plusieurs scénarios :
- Sans réseaux sociaux du tout,
- Avec l’usage observé aujourd’hui,
- Avec des limitations (1 h par jour maximum),
- Avec remplacement d’une partie du temps d’écran par de l’activité physique,
- Ou encore une interdiction ciblée chez les adolescents les plus à risque de dépression.
Le modèle a été calibré avec des données françaises issues de l’INSEE, de Santé publique France et de l’Observatoire français des drogues, et validé sur des données américaines pour tester sa fiabilité.
Des chiffres impressionnants
Les résultats du modèle sont frappants : l’usage excessif des réseaux sociaux serait associé à environ 590 000 cas supplémentaires de dépression parmi les adolescents français depuis 2000 (avec une fourchette allant de 400000 à 760 000)d.
Cela correspond à environ 799 suicides attribuables à cet excès, à 137 000 années de vie en bonne santé perdues, et à un coût économique total estimé à près de 4 milliards d’euros (soins, perte de productivité, etc.).
Autrement dit, d’après les auteurs, si les réseaux sociaux n’existaient pas, la dépression chez les adolescents aurait probablement stagné au lieu d’augmenter fortement depuis dix ans. Le modèle montre d’ailleurs qu’entre 2010 et 2022, le taux annuel de dépression chez les jeunes est passé de 4 % à 10 % en France — une tendance qui se retrouve aussi aux États-Unis.
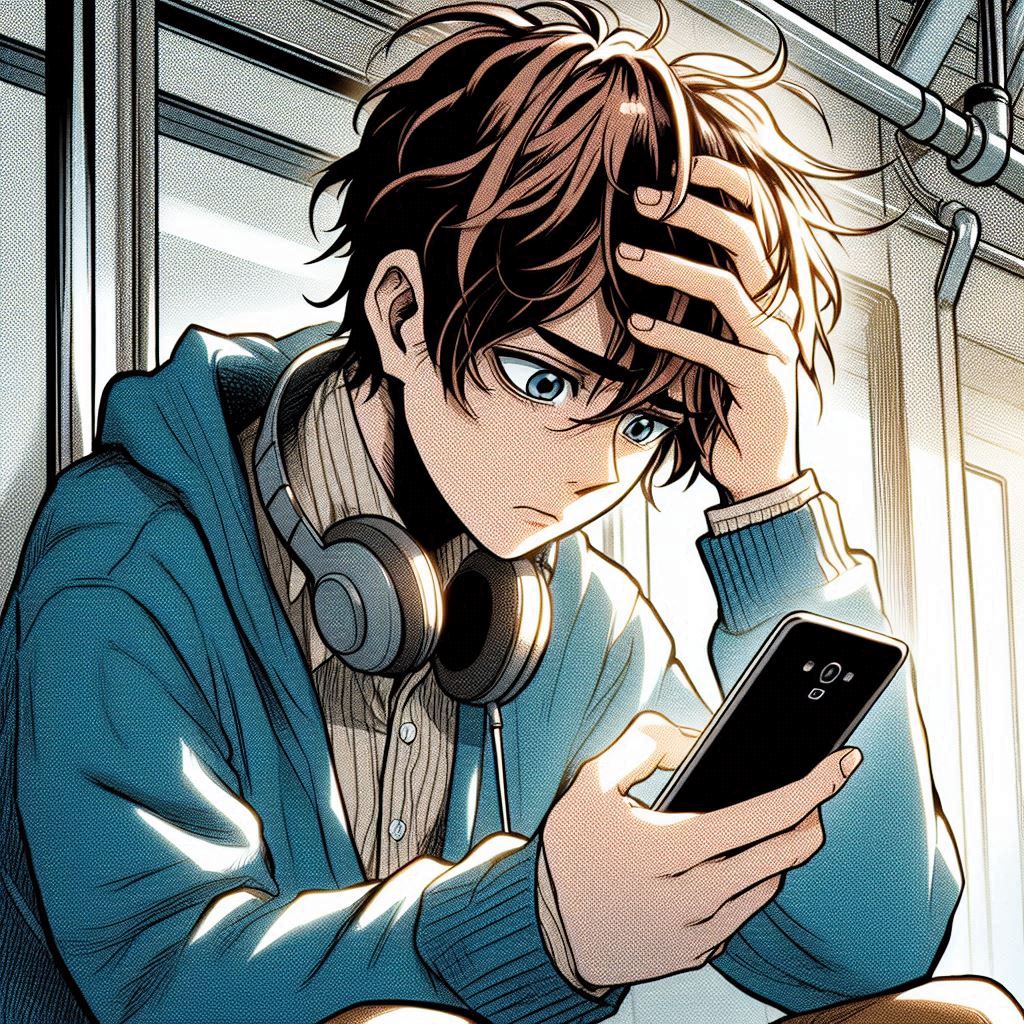
Limiter l’usage : un levier efficace
L’équipe de Hoertel ne s’est pas contentée de dresser un constat. Elle a aussi testé plusieurs stratégies de prévention. Trois d’entre elles se démarquent par leur impact :
- Limiter l’usage à 1 heure par jour réduirait la prévalence cumulative de la dépression de 14,7 %.
- Remplacer 30 minutes de réseaux par 30 minutes d’activité physique (comme la marche, le sport ou le jeu en plein air) permettrait une réduction de 12,9 %.
- Restreindre l’usage chez les adolescents les plus à risque (environ 10 % de la population) aboutirait à une baisse de 12 %.
La première mesure — la plus simple à mettre en œuvre à l’échelle collective — pourrait économiser 2,2 milliards d’euros en coûts directs et indirects. Ces résultats soulignent que de petits changements de comportement peuvent avoir un impact massif à l’échelle de la population.
Pourquoi les réseaux sociaux favorisent-ils la dépression ?
Le modèle ne se contente pas de montrer une corrélation : il s’appuie sur des travaux existants pour proposer plusieurs mécanismes explicatifs.
- La comparaison sociale : les adolescents se confrontent sans cesse à des images idéalisées, filtrées et retouchées, ce qui alimente le sentiment d’infériorité et la baisse d’estime de soi.
- Le cyberharcèlement, facilité par l’anonymat et la viralité, provoque stress, isolement et détresse émotionnelle.
- La perturbation du sommeil : l’usage nocturne des écrans retarde l’endormissement, réduit la durée et la qualité du sommeil, et favorise la fatigue chronique, un facteur reconnu de dépression.
- La dépendance comportementale : les “likes” et notifications activent les circuits de la récompense du cerveau, créant une addiction numérique et un désintérêt pour les interactions réelles.
- La sédentarité : le temps passé en ligne se fait souvent au détriment de l’activité physique, dont les bienfaits sur la santé mentale sont bien documentés.
En somme, les réseaux sociaux agissent comme un amplificateur de vulnérabilité, particulièrement chez les jeunes filles, plus sensibles aux comparaisons sociales et aux normes de beauté véhiculées en ligne.
Les limites du modèle
Les auteurs rappellent que leur approche reste modélisée — elle ne démontre pas une causalité directe. Plusieurs limites doivent être soulignées :
- Le modèle mesure le temps passé sur les réseaux, mais pas la qualité des interactions (positive, passive, hostile…).
- Il ne prend pas en compte les interactions complexes entre facteurs (par exemple, le cumul entre harcèlement et isolement familial).
- Les données d’usage proviennent d’enquêtes auto-déclarées, sujettes à sous-estimation.
- Enfin, les scénarios d’intervention sont théoriques : leur faisabilité réelle reste à démontrer.
Néanmoins, les simulations sont cohérentes avec les observations en France et aux États-Unis, ce qui conforte leur pertinence. Les chercheurs appellent à tester ces mesures dans la vie réelle, via des programmes éducatifs, des campagnes publiques ou des expérimentations scolaires.
A l’Observatoire Psycho-Social du Numérique, on regrette un peu le manque de d’informations fournies par les auteurs sur le poids accordé aux conditions socio-économiques dans leur modélisation. On connait pourtant l’importance de ces données et le lien qu’il existe entre le « temps d’écran » et le niveau « socio-économique ». C’est dommage, cela aurait permis de mieux de comprendre le poids de chacune des variables.
Notons également que la part expliquée de la variance (R²) n’est que de 0.04 ce qui est assez faible (ceci signifie que l’usage des réseaux sociaux n’explique que 4% de la variation du taux de dépression).
Des pistes concrètes pour agir
Face à ces résultats, plusieurs leviers se dessinent pour réduire les effets néfastes de l’hyperconnexion chez les jeunes :
- Éducation numérique : apprendre aux adolescents à reconnaître les contenus trompeurs, à gérer leur temps d’écran et à distinguer leurs émotions en ligne.
- Encadrement parental : instaurer des règles simples (par exemple, pas d’écran à table ni avant le coucher) et favoriser les activités hors ligne.
- Régulation des plateformes : limiter les algorithmes de captation de l’attention, lutter contre le harcèlement, et mieux protéger la vie privée des mineurs.
- Promotion du sport et du plein air, véritables antidotes naturels à la dépression. Cette étude confirme d’ailleurs des résultats antérieurs que nous avons déjà présentés (sur l’importance de l’activité physique et du temps passé en extérieur).
- Surveillance de la santé mentale : renforcer le dépistage précoce dans les écoles et les consultations de médecine générale.
Ces actions combinées pourraient non seulement réduire la dépression, mais aussi améliorer la qualité de vie et les relations sociales des jeunes générations.
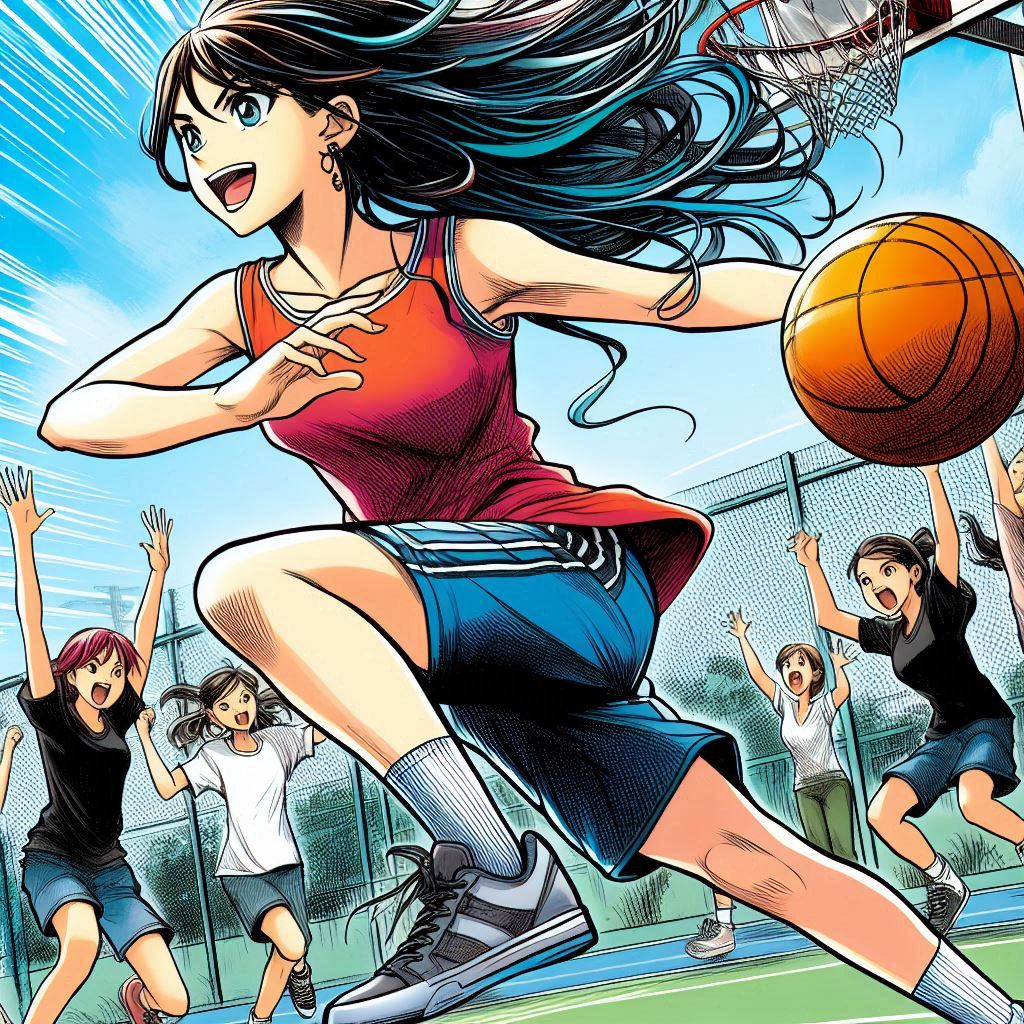
L’étude de Hoertel et ses collègues apporte un argument scientifique intéressant à un débat souvent dominé par les opinions. Elle ne diabolise pas les réseaux sociaux, mais rappelle qu’ils ne sont pas neutres pour la santé mentale.
Le message est clair : le risque ne réside pas dans l’existence des réseaux, mais dans leur usage excessif et non régulé. Comme l’alimentation ou le sommeil, l’équilibre est la clé.
Les auteurs concluent : “Limiter le temps d’écran, promouvoir l’activité physique et soutenir les jeunes les plus vulnérables sont des stratégies à fort potentiel de bénéfice collectif.”
À l’heure où les adolescents passent en moyenne trois à quatre heures par jour sur les réseaux, cette étude sonne comme un appel à repenser nos habitudes numériques — pour redonner à la jeunesse un peu d’air, de mouvement… et de santé mentale.
Si la structure de cette étude est innovante et prometteuse, l’impossibilité d’établir un lien de causalité ainsi que certaines imprécisions méthodologiques doivent nous faire considérer ses résultats quant à la relation entre réseaux sociaux et dépression avec prudence.