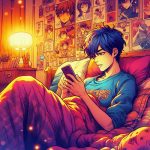L’utilisation des technologies par les parents en présence de leur jeune enfant, que l’on appelle aujourd’hui « technoférence », est une réalité omniprésente dans de nombreux foyers modernes. Cette pratique, souvent liée à l’usage des smartphones ou tablettes, soulève des questions sur l’impact potentiel de la distraction parentale numérique sur la santé et le développement des enfants de moins de 5 ans. Une méta-analyse récente publiée dans JAMA Pediatrics fait le point sur ce phénomène, en s’appuyant sur 21 études impliquant près de 15 000 participants dans 10 pays.
On vous explique.

Un phénomène massif et quotidien
D’après les données actuelles, plus de 70% des parents interagissent avec la technologie alors qu’ils jouent ou mangent avec leurs enfants – et 89% admettent le faire au moins une fois par jour. Si les smartphones et autres appareils connectés offrent de nombreux atouts – se divertir, rester en contact avec ses proches, s’informer ou souffler un moment – leur présence constante peut provoquer des interruptions fréquentes dans les interactions parents-enfants.
La technoférence se manifeste principalement sous deux formes :
- La distraction : le parent utilise son appareil pendant que l’enfant est à proximité, sans qu’il y ait de rupture franche d’interaction.
- L’interruption : la technologie (appel, message, notification…) coupe une interaction en cours entre le parent et l’enfant.
Les conséquences de ces perturbations des interactions sont encore mal comprises, motivant des recherches approfondies sur leur portée pour le développement des tout-petits.
Résultats
Impacts sur le développement cognitif et psychosocial
La méta-analyse a sélectionné des études qui examinaient les liens entre l’utilisation parentale de la technologie et des critères de développement essentiels chez l’enfant de moins de 5 ans. Plusieurs domaines ont été analysés :
Cognition (attention, fonctions exécutives, auto-régulation)
Les enfants dont les parents ont déclaré un usage fréquent de la technologie en leur présence obtiennent en moyenne des résultats légèrement inférieurs dans les tests de performances cognitives (r = −0.14 ; intervalle de confiance à 95% : −0.23 à −0.04).
Comportements psychologiques et affectifs
La technoférence s’accompagne d’une augmentation des comportements dits « internalisés » (anxiété, retrait, émotions négatives) chez l’enfant (r = 0.13 ; IC 0.08 à 0.19).
Les comportements « externalisés » (agitation, colères, troubles du comportement) sont également plus fréquents (r = 0.15 ; IC 0.09 à 0.21).
Le niveau d’attachement parent-enfant est légèrement mais significativement réduit en cas de technoference (r = −0.10 ; IC −0.19 à −0.01).
Le comportement prosocial (empathie, partage, coopération) diminue aussi (r = −0.08 ; IC −0.13 à −0.02).
Ces associations sont jugées faibles à modérées, mais statistiquement significatives, et soulignent que la disponibilité émotionnelle et l’attention du parent sont indispensables pour soutenir le développement global de l’enfant.
Effet miroir sur la consommation d’écran de l’enfant
Autre observation marquante : la fréquence d’utilisation de la technologie par le parent prédit le temps d’écran chez l’enfant (r = 0.23 ; IC 0.13 à 0.32). Cela peut s’expliquer par plusieurs mécanismes : les enfants pourraient utiliser des écrans pour s’occuper lorsque leur parent est absorbé par son propre appareil.
Les parents « modélisent » inconsciemment un comportement d’usage intensif des écrans, que l’enfant imite.
Dans certains cas, les parents peuvent recourir aux écrans pour calmer ou occuper leur enfant pendant qu’ils gèrent eux-mêmes leurs activités numériques.
Ces effets sont préoccupants car la quasi-totalité des enfants de moins de 5 ans excède aujourd’hui les recommandations officielles concernant le temps d’écran.
Rien sur le développement moteur, l’activité physique et le sommeil
La méta-analyse met en avant une lacune majeure dans la recherche : aucun des 21 articles inclus n’a étudié l’impact de la technoférence sur le développement moteur, l’activité physique ou le sommeil des jeunes enfants. Ces dimensions pourtant vitales du développement restent largement inexplorées, alors même qu’elles sont souvent liées à l’utilisation des technologies et au temps passé devant les écrans.
Types de technoférence : distraction ou interruption ?
Contrairement à certains présupposés, l’étude n’a pas trouvé de différence significative selon que la technoférence était liée à une simple distraction ou à une interruption franche de l’interaction parent-enfant. Les deux dynamiques semblent avoir des conséquences similaires sur le développement cognitif et psychosocial.

Comment expliquer ces effets ?
La qualité des interactions est essentielle dans les premières années de la vie pour stimuler l’apprentissage du langage, de la cognition et des compétences sociales et émotionnelles. Lorsqu’un parent est absorbé par son téléphone, la réactivité, la chaleur et la disponibilité émotionnelle peuvent diminuer. L’enfant risque alors d’être frustré, de recevoir moins de stimulations ou de réponses, ce qui peut freiner son développement, même si les effets restent modestes.
La technoférence s’apparente ainsi à des occasions manquées : moins de jeux partagés, de conversations, d’interactions « en miroir » qui font grandir l’enfant.
Quelles orientations pour les familles et la société ?
Les résultats disponibles n’en font pas pour autant des technologies les « ennemies » des parents. Les appareils numériques peuvent soutenir la parentalité lorsqu’ils sont utilisés de façon réfléchie et maîtrisée. Toutefois, réguler l’usage des écrans en présence des tout-petits et privilégier le partage (« coviewing », co-utilisation) pourrait permettre de préserver la qualité de la relation et de limiter les risques pour le développement.
Nous vous invitons à ce titre à regarder la conférence intitulée « Parentalité Numérique » évoquée dans cet article ici )
L’étude invite aussi à développer de nouveaux outils pour mesurer précisément le phénomène, en tenant compte du contexte, des types de contenus consultés et des appareils utilisés. Enfin, il est recommandé de suivre de près les effets à long terme et de s’intéresser davantage aux aspects moteur, physique et au sommeil.

Conclusion
La technoférence parentale est un phénomène courant, dont les conséquences potentielles sur l’enfant, bien que généralement faibles, sont désormais mieux documentées : moindre cognition, altération de l’attachement, hausse des problèmes de comportement et du temps d’écran, diminution du comportement prosocial. Cet état des lieux incite à repenser la place du numérique dans les routines familiales et à promouvoir la disponibilité parentale, en particulier dans les moments clés de l’interaction et de l’apprentissage chez le jeune enfant.