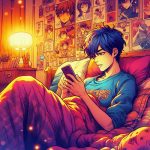Addiction ou pas addiction, en ce qui concerne les réseaux sociaux ? Vous le savez, on vous le dit régulièrement, en septembre 2025, l’addiction à Internet, au smartphone, au réseaux sociaux ou aux écrans n’est toujours pas reconnue officiellement comme une entité pathologique.
Cela ne veut pas dire que ce trouble n’existe pas. Cela signifie simplement que pour l’instant, la science manque de preuves pour trancher cette question.
Mais pour établir la vérité, les chercheurs ont besoin d’outils. Et c’est justement l’objet de l’étude que nous vous proposons aujourd’hui. Une équipe internationale vient de remettre en cause un modèle fréquemment utilisé pour évaluer les addictions comportementales. Les tests que l’on utilise pour évaluer ces comportements ne sont donc probablement pas adaptés…
On vous explique.
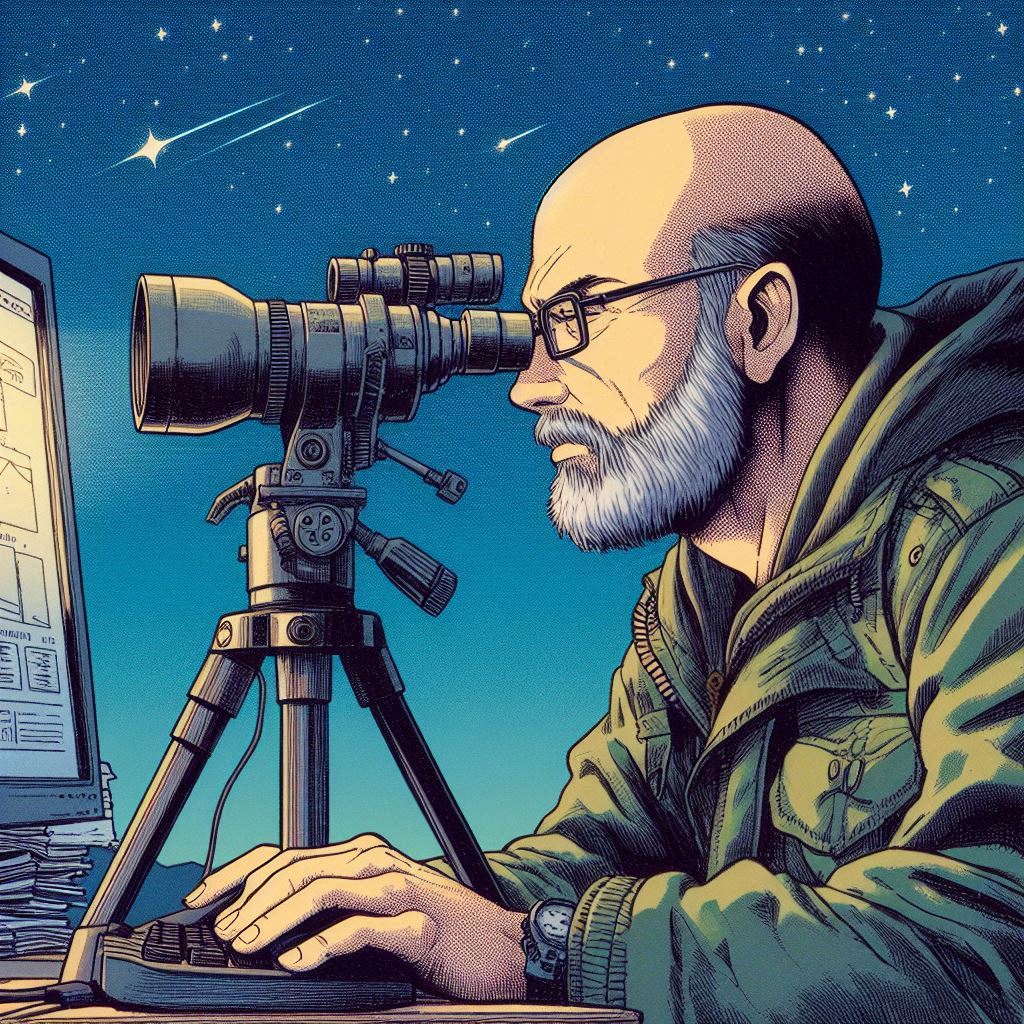
Origine et portée du modèle des six composantes
Depuis vingt ans, le concept d’addiction comportementale s’est largement répandu: travail, shopping, sport, réseaux sociaux, amour… Ces « addictions » sont souvent évaluées à l’aide du modèle des six composantes :
- Saillance : le comportement envahit la pensée et devient central dans la vie.
- Tolérance : il faut intensifier ce comportement pour obtenir le même effet.
- Modification de l’humeur : l’activité entraine une modification des émotions.
- Rechute : il est difficile de stopper le comportement qui reprend après des tentatives d’arrêt.
- Sevrage : des sensations désagréables apparaissent en l’absence du comportement.
- Conflit : tensions internes ou familiales liées au comportement.
Ce modèle a été popularisé par Griffiths (2005), et repris dans des outils comme le Bergen Social Media Addiction Scale (BSMAS), largement utilisé pour détecter une potentielle addiction aux réseaux sociaux.
Critique du « tout addictif »
Les auteurs dénoncent une dérive : transposer de façon systématique les critères de dépendance aux substances vers des comportements de la vie courante favorise la pathologisation excessive. On risque ainsi de désigner comme « malades » des personnes seulement très investies dans une passion ou une activité normale.
Méthodologie
La recherche s’est basée sur un large échantillon : 4 256 participants italiens, âgés de 13 à 78 ans, ont rempli plusieurs questionnaires :
- Le BSMAS sur l’addiction aux réseaux sociaux.
- Différents outils de mesure de la santé mentale (dépression, anxiété, stress, etc.).
Les chercheurs ont appliqué :
- Des analyses factorielles (pour la structuration du questionnaire).
- Des analyses en réseau permettant d’étudier les liens entre addiction et troubles psychologiques.

Résultats : une structure bidimensionnelle inattendue
Contrairement à l’idée que les six critères forment un seul syndrome, les résultats montrent la présence de deux groupes distincts :
- Saillance et tolérance : ils forment une première dimension, mais n’ont aucun lien avec les symptômes de souffrance psychique. Ce sont des éléments périphériques, caractéristiques d’un usage passionné ou intense mais non pathologique.
- Modification de l’humeur, rechute, sevrage, conflit : ces critères forment une seconde dimension qui, elle, est fortement associée à la présence de troubles psychologiques (anxiété, dépression, stress…).
L’étude montre donc que l’usage fréquent ou la pensée récurrente à une activité n’est pas automatiquement le signe d’une addiction mais plutôt celui de l’engagement.
Conséquences théoriques et cliniques
Le danger, selon les auteurs : utiliser le modèle des six composantes pour évaluer les addictions aux réseaux sociaux peut conduire à faussement diagnostiquer une addiction chez des individus simplement passionnés ou engagés.
Les implications sont majeures :
- Nécessité de distinguer critères centraux (souffrance, perte de contrôle, conflits, etc.) des critères périphériques (engagement, intensité).
- Risque d’inflation des diagnostics et de stigmatisation sociale par surpathologisation des comportements courants.
Discussion : Pour une évaluation plus nuancée
Les auteurs recommandent une révision profonde de la conceptualisation des addictions comportementales :
- Il faut revoir les instruments de mesure pour qu’ils ne confondent pas engagement élevé et véritable trouble psychologique.
- L’évaluation doit privilégier les critères liés à la souffrance, à la détresse et à la perte de contrôle, et non uniquement à l’intensité ou à la fréquence de l’activité.
Macro-épidémiologiquement, ces recommandations invitent à la prudence, afin d’éviter le piège du « tout addictif », qui risquerait de transformer toute passion en maladie, avec le risque d’un usage abusif des ressources cliniques et d’une stigmatisation injustifiée.
Limites et perspectives
- La structure du questionnaire BSMAS ne mesure par exemple la régulation de l’humeur qu’à travers la réduction d’affects négatifs, ce qui ne rend pas toute la richesse des possibles.
- Les analyses reposent sur des bases de données agrégées, apportant robustesse mais aussi variabilité potentielle dans les résultats.

Conclusion
Cette étude suggère fortement qu’une simple fréquence d’utilisation ou un fort intérêt pour les réseaux sociaux ne suffit pas à diagnostiquer une addiction. Les seuls signes pertinents d’une addiction comportementale sont ceux qui induisent une réelle souffrance ou désorganisation psychologique ou sociale. Il devient donc crucial de réformer ces outils pour éviter de transformer l’engagement normal en motif d’inquiétude ou de stigmatisation.
De la même façon que pour savoir si on a de la fièvre, il faut un thermomètre adapté et fonctionnel, pour savoir si une addiction aux réseaux sociaux existe, nous avons besoin de tests bien étalonnés. Dans le cas contraire, nous risquons de surdiagnostiquer ce trouble, qui n’en est peut-être même pas un.
En résumé, la frontière entre passion saine et addiction pathologique aux réseaux sociaux doit être repensée pour protéger de la surpathologisation et adapter correctement l’accompagnement et la prévention.