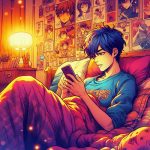Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de mortalité dans le monde. Leur développement silencieux commence souvent bien avant l’âge adulte, via l’installation précoce de facteurs de risque cardiométaboliques : tour de taille, hypertension, anomalies des lipides sanguins, glycémie élevée, résistance à l’insuline ou inflammation chronique par exemple. L’identification précoce et la prévention de ces risques sont cruciales.
Or, le mode de vie des jeunes a radicalement changé : le temps d’écran explose dès l’enfance, tant pour le divertissement que l’apprentissage ou les relations sociales. Plusieurs études ont pointé un lien entre excès d’écrans et augmentation de ces risques. Mais celles-ci souffrent souvent de limites méthodologiques : mesures subjectives, manque d’ajustement pour des facteurs comme le sommeil, l’activité physique ou l’alimentation. L’étude COPSAC (Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood) ambitionne d’aller plus loin, en suivant plus de 1 000 jeunes danois de manière longitudinale, en intégrant des mesures fines et en isolant le rôle spécifique des écrans.
L’étude danoise que nous vous proposons aujourd’hui offre une perspective trop ignorée : les conséquences physiques du temps passé devant un écran. En effet, à l’OPSN, nous vous éclairons essentiellement sur les conséquences sociales, cognitives ou psychologiques du numérique, mais plus rarement sur ce que les écrans font sur notre corps.
Donc aujourd’hui, on palie à ce manquement. On vous explique.

Méthodologie : deux cohortes, des mesures multi-factorielles
Les auteurs de l’études ont analysé des sources de données:
– COPSAC2010 qui est une étude prospective de population générale qui comprend 700 paires mère-enfant bénéficiant d’un phénotypage poussé lors de 14 visites cliniques et d’évaluations des expositions depuis la naissance jusqu’à l’âge de 10 ans
– COPSAC2000 qui est également une cohorte prospective mère-enfant composée de 411 enfants nés de mères asthmatiques, bénéficiant d’un phénotypage approfondi lors de 19 visites cliniques et d’évaluations des expositions depuis la naissance jusqu’à l’âge de 18 ans.
Ils ont ainsi pu obtenir un certain nombre de mesures, telles que:
- Temps d’écran mesuré hors obligation scolaire, en semaine et le week-end, à l’âge de 6 ans et de 10 ans.
- Facteurs de risque cardiométaboliques (CMR) principal outcome : Z-scores du tour de taille, tension artérielle systolique (TAS), HDL (bon cholestérol), triglycérides, glucose. Ajustement pour sexe/âge/hauteur.
- Outcomes secondaires : HOMA-IR (résistance à l’insuline), CRP haute sensibilité, GlycA (inflammation), ApoB (lipoprotéines athérogènes), HbA1c (moyenne de la glycémie), anthropométrie complète (IMC, masses grasse et musculaire…).
- Métabolomic signature par NMR sanguine (mesure de 173 biomarqueurs).
- Score de risque cardiovasculaire projeté : modèle Cox du UK Biobank appliqué aux données enfants/adolescents.
Des variables modératrices et covariables ont également été choisies : durée et heure du sommeil (accéléromètre 14 jours), activité physique, sédentarité, régime alimentaire, progression pubertaire (hormones), statut socio-économique, antécédents tabac maternel, nombre de frères/sœurs, symptômes d’ADHD.
Les chiffres clés du temps d’écran
Les données des auteurs de l’étude, concernant les enfants danois montrent que ces derniers restent devant un écran en moyenne:
- À 6 ans: 2 heures/jour.
- À 10 ans : 3,2 heures/jour.
- À 18 ans : 6,1 heures/jour. Il est à noter que les garçons utilisent plus d’écrans que les filles à l’adolescence (6,6 vs 5,7h/j).
Le temps d’écran augmente fortement avec l’âge et est corrélé à une diminution de plusieurs comportements sains (moins de sommeil, moins d’activité physique, davantage de temps sédentaire, alimentation plus occidentalisée).

Principaux résultats : association écran et santé métabolique
Les auteurs révèlent un effet significatif et indépendant du temps d’écran:
- Enfants 6-10 ans : pour chaque heure supplémentaire quotidienne passée devant un écran on constate une augmentation de 0,08 point du score CMR, effet renforcé à 10 ans (+0,12 point).
- Adolescents 18 ans : chaque heure passée devant un écran est quant à elle associée à une augmentation de 0,13 point du score CMR.
- Ces associations demeurent après ajustement sur sédentarité, activité physique, sommeil, alimentation et statut socio-économique.
- Les garçons affichent des associations plus fortes pour certains items (tour de taille, tension, masse grasse et muscle), mais sans interaction statistique significative selon le sexe.
Autres effets associés :
- Tour de taille et TAS plus élevés.
- HDL plus bas.
- Triglycérides plus élevés.
- Résistance à l’insuline accrue (HOMA-IR), surtout si le temps d’écran augmente entre 6 et 10 ans.
- Marqueurs d’inflammation (GlycA, CRP) et ApoB (lipoprotéines athérogènes) plus élevés à 18 ans.
- À 10 ans, pas de lien significatif entre écran et IMC, masse grasse ou muscle.
- À 18 ans, chez les garçons : temps d’écran corrélé à hausse IMC, poids, graisse, muscle, indice de graisse, os, etc. Chez les filles, l’association significative ne concerne que l’IMC et tendance pour le poids et la masse grasse.
Le rôle du sommeil, modulateur majeur
Les modèles statistiques produits par les scientifiques montrent des corrélations directes entre temps d’écran, sommeil et CMR, indépendamment des autres variables. L’effet négatif du temps d’écran est amplifié en cas de sommeil court ou de coucher tardif :
- Durée de sommeil : les effets du temps d’écran sur le risque CMR sont accentués chez ceux qui dorment moins.
- Heure d’endormissement : chez l’enfant, coucher plus tard aggrave les effets du temps d’écran (P=0,009) ; chez les filles adolescentes, même observation.
- 12 % de l’association écrans/risque passe par la réduction du temps de sommeil (médiation validée par l’analyse statistique).
- La sédentarité, l’activité ou le régime occidental ne modèrent pas significativement le lien dans cette étude.
Les auteurs ont également réalisé des analyses selon le sexe afin d’examiner d’éventuelles différences dans les effets de cette modération de l’effet des écrans. Chez les garçons de la cohorte COPSAC2010, l’interaction entre le temps d’écran et la durée de sommeil était plus marquée. En revanche, chez les filles de la cohorte COPSAC2000, l’interaction entre le temps d’écran et l’heure d’endormissement était significative, ce qui suggère que l’effet délétère du temps d’écran sur le risque cardio-métabolique (CMR) est accentué lorsque l’heure d’endormissement est plus tardive chez les adolescentes.

Screen Time : une signature métabolique sanguine identifiée
Au-delà des paramètres classiques, l’équipe a utilisé le machine learning pour identifier une empreinte biologique du “trop d’écran” sur 173 biomarqueurs :
- 37 biomarqueurs sont retenus, majoritairement des triglycérides (VLDL) et une diminution des grandes particules HDL.
- Cette signature formée chez les enfants prédit les usages d’écran chez les adolescents, même si leur mode de vie diffère, prouvant une robustesse inter-cohorte.
Pour les chercheurs, cela ouvre la voie à des outils de “prédiction sanguine” permettant d’identifier précocement les jeunes à risque.
Risque cardiovasculaire projeté (modèle adulte appliqué aux jeunes)
- À 18 ans, le score de risque adulte (UK Biobank, appliqué sur les données métabolomiques) est positivement associé au temps d’écran.
- À 10 ans, la tendance est équivalente mais non significative.
Ces résultats suggèrent que la perturbation métabolique associée aux écrans chez l’adolescent se rapproche progressivement de celle qui, chez l’adulte, précède les maladies cardiovasculaires.
Limites méthodologiques
- Autodéclaration du temps d’écran : ce type de recueil de données rend possible un biais de sous-estimation, même si les résultats concordent avec les études basées sur la captation par caméras embarquées.
- Observation et non intervention : le lien causal est suggéré mais non démontré formellement.
- Effets de petite taille mais significatifs et accumulés à l’échelle collective.
- Alimentation mesurée de façon subjective.
- Manque de précision sur les types d’écran, la durée et la qualité du sommeil, l’heure d’exposition.
- Il aurait également été intéressant de pouvoir comparer cette population à une population aussi sédentaire mais pour d’autres raisons (des jeunes passant beaucoup de temps à lire mais privés d’écran, par exemple). Mais nous sommes conscients qu’une telle population n’existe probablement plus en 2025.
Implications de santé publique et recommandations
Le temps d’écran des jeunes apparaît comme un comportement modifiable, à intégrer dans la prévention des risques cardio-métaboliques.
L’étude suggère de :
- Limiter le temps d’écran dès l’enfance, surtout le soir.
- Privilégier un coucher régulier et précoce, sans écran avant le sommeil.
- Éduquer familles et enfants dès le primaire sur les mécanismes et risques, pour éviter le cumul écran/sommeil court qui multiplie les effets négatifs.
- Politique multifactorielle : inclure l’hygiène du sommeil, l’activité physique, la nutrition et la gestion du stress.
La médecine pourrait tirer parti de la signature métabolomique pour cibler de manière personnalisée les enfants ou ados les plus à risque (monitoring sanguin), proposant des interventions combinées sur le mode de vie.

Conclusion et perspectives
En résumé, plus de temps d’écran est associé à un profil métabolique défavorable dès l’enfance et aggravé à l’adolescence, surtout si le sommeil est insuffisant ou tardif. Ces liens sont indépendants des autres habitudes de vie, suggérant des effets spécifiques des écrans et de leur impact nocturne.
Les signatures biologiques et les scores de risque projetés montrent que les perturbations observées se rapprochent de celles qui, à l’âge adulte, conduisent aux maladies cardiovasculaires.
Agir tôt, sur tous les leviers (écran, sommeil, alimentation, activité), pourrait avoir un bénéfice majeur à long terme, pour préserver la santé métabolique des jeunes générations.
La prise en compte de facteurs autres que ceux habituellement retenus pour orienter les décisions politiques (cognitifs, psychologiques…), tels que les critères somatiques ou biologiques par exemple, est un impératif.
De la même façon que d’après Jacques Chirac, François Mitterrand n’avait pas le monopole du cœur, les psychologues ne peuvent avoir le monopole du numérique.